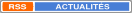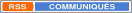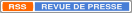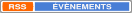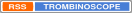Open data, données ouvertes pour un monde ouvert ou totalitaire - Les Temps électriques
Titre : Open data, données ouvertes pour un monde ouvert... ou totalitaire
Intervenant·e·s : François Paychère - Yannick Meneceur - Sophie Sontag Koening
Lieu : Émission Les Temps électriques - Amicus Curiae
Date : mars 2018
Durée : 28 min 40
Écouter ou enregistrer le podcast
Présentation de l'émission
Licence de la transcription : Verbatim
Illustration : Legal Gavel & Open Law Book, Wikimedia Commons - Licence Creative Commons Attribution 2.0 Generic
NB : transcription réalisée par nos soins, fidèle aux propos des intervenant·e·s mais rendant le discours fluide.
Les positions exprimées sont celles des personnes qui interviennent et ne rejoignent pas nécessairement celles de l'April, qui ne sera en aucun cas tenue responsable de leurs propos.
Transcription
Yannick Meneceur : Les Temps électriques, l’occasion de s’interroger sur l’avenir de la justice que nous nous préparons. Nous recevons aujourd’hui François Paychère, magistrat à la Cour des comptes de Genève, pour parler d’''open data et de transparence, mais aussi des conséquences. Le numérique ne nous conduirait-il pas vers une nouvelle forme de totalitarisme ? François Paychère a dirigé au Conseil de l’Europe, en tant que président du groupe de travail qualité de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice, des travaux relatifs à la cyberjustice. Il a d’ailleurs été auditionné par une mission française, la mission Cadiet1, sur l’ouverture de l’open data encore récemment. Bienvenue François Paychère.
François Paychère : Bonjour Yannick.
Yannick Meneceur : Le XXIe siècle sera transparent ou ne sera pas. Un vent nouveau semble en effet souffler ces dernières années sur les politiques publiques occidentales avec un certain nombre de concepts où le rapport des citoyens avec leurs gouvernants paraît devoir se transformer, d’une relation verticale, contrôle-soumission, à un rapport plus horizontal, dans une totale transparence de l’action publique. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en posait évidemment les bases, en imposant à tout agent public de rendre compte de son administration. Mais les politiques d’ouverture des données nous conduisent sur un bien autre chemin. Redéfinissons rapidement quelques concepts utilisés et parfois maltraités dans les débats.
Une première confusion est fréquente entre « accès à l’information » et « accès aux données ». En effet, un certain nombre d’informations publiques nécessitant une large publicité bénéficient déjà des nouvelles technologies pour assurer leur diffusion. Ainsi Légifrance2 est le premier canal dématérialisé d’information certifiée où l’on trouve aussi bien des textes législatifs ou réglementaires que de la jurisprudence ou des nominations à des emplois publics. Mais cette information unitaire, même disponible sur Internet, est totalement distincte de l’accès direct à des données organisées et constituées en bases pouvant être traitées par un ordinateur. L’open dataconcerne donc seulement la diffusion de ces bases qui, agglomérées en tout ou partie avec d’autres sources structurées, constituent le big data.
La seconde confusion consiste à confondre l’ouverture des données elles-mêmes avec leurs moyens de traitement. Nombre de discours sur cette ouverture concernent en réalité les traitements opérés par diverses méthodes avancées que l’on qualifie globalement de Data Science : justice prédictive avec de l’intelligence artificielle, moteurs de recherche avancés avec divers critères, robots juristes, sont autant d’applications algorithmiques qui sont nourries de données mais n’ont rien à voir avec la politique d’ouverture elle-même. Les données, c’est le pétrole, donc le carburant du XXIe siècle et les algorithmes, le moteur. L’ouverture de ces données ne s’opère donc pas de manière si anodine que cela. Alors oui, quand l’Open Government Partnership3 lancé en 2011 sur la base d’un accord multilatéral avec 70 pays à bord, soutenu par le Tides center4, organisation philanthropique américaine, déclare solennellement que cette gouvernance 2.0 ou 3.0, je m’y perds, va favoriser la transparence de l’action publique, prévenir la corruption, associer les citoyens aux politiques publiques, on peut y lire un nouvel achèvement pour la démocratie.
Mais concrètement, qui, dans la société civile, aura les moyens de traiter ces données ?
Spécifiquement pour les décisions judiciaires, qui va bénéficier directement de l’ouverture de ce marché et même si l’on ne discutera pas aujourd’hui d’une application spécifique, quelle transformation, par exemple dans la construction de la jurisprudence, anticiper ? Enfin, comment articuler cette ouverture avec le Règlement européen sur la protection des données5 qui entrera en vigueur le 25 mai 2018 ? Puisque open data ne rime pas nécessairement avec données anonymes, le nom des juges administratifs français, en tout cas certains présidents de formation du jugement, sont déjà ouverts.
Cher François Paychère, vous n’êtes pas encore riche émir propriétaire d’un puits de données, mais vous avez réfléchi et approfondi la question de leur ouverture sur un plan bien plus large que la seule question helvético-helvétique ou franco-française et, comme je le rappelais, vous avez été auditionné par la mission dirigée par le professeur Cadiet sur l’open data et la décision de justice en France.
Alors, cher François, débutons cette rencontre et cet échange autour de l’open data'' avec Sophie. Pensez-vous que cet ''open data'' soit la meilleure des choses qui soit arrivée à la justice depuis l’''De l'esprit des lois de Montesquieu ?
François Paychère : Cher Yannick, si vous permettez, je vais prolonger l’image aquatique du puits en vous parlant des carpes. Il y a encore 25 ans, les administrations publiques dans nos pays étaient semblables aux carpes de nos étangs : elles nageaient au fond, absorbaient toutes sortes d’informations, toutes sortes de données, mais elles n’en restituaient aucune. À mon sens, ce qui s’est passé de très important peut-être non pas depuis Montesquieu, mais, en tout cas, au cours de ce dernier quart de siècle, c’est l’ouverture de l’administration et le triomphe du principe de la transparence. Quand on dit « principe de la transparence », c’est en fait un terme, j’ai presque envie de dire un slogan, qui recouvre des réalités bien différentes. Dans les pays nordiques, on était déjà habitué à cela, souvenez-vous de l’exemple qu’on prenait souvent de ces administrations communales dans les pays du Nord dans lesquels il était obligatoire d’ouvrir tout le courrier reçu par la mairie chaque matin, de le poser sur une table où chacun pouvait venir le lire. Et on était bien loin de ça du côté des Alpes.
Ce qui se passe, c’est que ce triomphe du principe de la transparence en matière d’administration publique s’étend maintenant, peut-être grâce à des progrès techniques, dans le monde de la justice.
Yannick Meneceur : Donc finalement, avec l’open data, rien de nouveau sous le soleil par rapport aux principes de transparence qui existent en effet depuis déjà longtemps et exigés à toute l’administration publique.
François Paychère : Tout à fait. L’inversion du paradigme, le passage du secret à l’accès, c’est quelque chose qui dépend du triomphe du principe de la transparence et qui est antérieur à la discussion que nous avons sur l’open data en matière de décision de justice. Cela étant, il faut bien sûr garder présent à l’esprit que tout cela est tributaire des cultures nationales.
Sophie Sontag Koening : Yannick est parti de Montesquieu, de la culture française, moi j’ai envie de vous demander si vous pensez que la philosophie de l’open data ne serait finalement pas très différente selon les cultures. Une approche française ou helvétique, finalement, peut-elle être comparée à celle anglo-saxonne ?
François Paychère : Il y a certainement des points de comparaison, il y a des philosophies très différentes là-derrière. Si on se restreint maintenant au domaine qui est celui du droit, pour bien comprendre le droit anglo-saxon, je crois qu’il faut le comparer à une pièce de tissu, par exemple à l’écharpe que chacun d’entre nous portons aujourd’hui puisqu’il fait froid. Elle est composée d’une série de nœuds qui ont été tissés. Et ce tissu, cette pièce de vêtement, c’est un web en anglais, c’est le fait que chacun des nœuds doit être cohérent avec celui qui le précède et celui qui le suit pour que la pièce de tissu soit bien élégante. En matière de justice, c’est exactement la même chose : le principe important de la Case law6 c’est de conserver une cohérence. Ça a comme impact que, quel que soit le moyen technique, la publication est quelque chose d’important. Si maintenant nous passons la Manche, avec ou sans tunnel, nous arrivons en France où le principe est totalement différent : le juge n’est que la bouche de la loi, il ne fait qu’actualiser des principes qui sont contenus dans le texte législatif, donc en fait son œuvre personnelle est beaucoup moins importante, en tout cas, disons, sur le plan théorique, sur le plan de la théorie du droit, que celle de son collègue anglo-saxon.
Sophie Sontag Koening : D'accord. Concrètement, en quoi finalement l’open data constitue-t-il une amélioration en termes d’accès à la justice pour le justiciable ? C’est-à-dire qu’on a une ouverture à plus de décisions de jurisprudence, est-ce qu’on peut considérer que ça favorise une meilleure transparence de la justice ?
François Paychère : Je ne crois pas que la masse, je ne crois pas que le nombre favorise l’accès et la transparence. Je ne le crois absolument pas. On pourrait très bien faire une analyse tout à fait cynique de la situation et dire que le meilleur moyen de tuer le mouvement de l’open data, c’est d’ouvrir l’accès au public à tellement de données que ce public va être noyé sous les données. Donc c’est vrai que derrière ce mouvement-là, il y a un risque de perte de la compréhension du système.
Yannick Meneceur : C’est exactement la question que je me pose, puisque les articles 20 et 21 de la loi pour une République numérique7 ont rompu avec d’anciens principes de sélection de décision - on pourra y revenir, si vous le voulez parce que c’est assez intéressant ce changement de paradigme. J’entends tout à fait que la masse ne fait pas la transparence, mais ce qui m’intéresse c’est aussi le sens. Est-ce que vous croyez que de la masse des décisions produites par les juridictions on puisse saisir, appréhender, imaginons cela, non seulement l’esprit du législateur mais l’esprit même de la loi ?
François Paychère : Alors, retournons outre Manche. Il y a encore 25 ou 30 ans, dans les bibliothèques de droit anglaises, il y avait des bibliothécaires qui passaient une bonne partie de leur temps à coller des petits stickers dans la marge des recueils de jurisprudence pour renvoyer le lecteur soit à une décision qui divergeait de celle qu’ils commentaient par le biais de ces stickers, soit à une décision qui allait dans le même sens. Cela créait du sens comme ça, parce que cela créait le réseau.
Sur le continent, la théorie est que c’est pas nécessaire parce qu’il y a les principes législatifs qui chapeautent le tout.
Cela étant, il faut aussi être honnête. De la masse des décisions, notamment de première instance, naît quotidiennement du sens et il y a une sorte de création horizontale du droit, c'est d'ailleurs un thème qu'on pourra développer, qui fait que ça vaut la peine de connaître ce qui se passe au-delà du travail des juridictions suprêmes. Je pense que le vrai débat, d’ailleurs le rapport que vous avez mentionné tout à l’heure n’y répond pas vraiment, c’est de savoir jusqu’où les États veulent s’engager pour donner du sens à ces données. On a une masse de données, c’est l’open data, est-ce qu’on les livre de manière brute à des éditeurs qui, eux, vont donner du sens en offrant des outils d’analyse, en faisant tout ce travail intellectuel qui n'est pas fait quand on a simplement la masse de données, ou est-ce que l’État lui-même veut s’engager sur cette piste ?
Yannick Meneceur : Ce que vous évoquez, François, a été analysé par le Conseil de l’Europe. Notamment, Sophie, vous avez aussi travaillé sur cette évaluation de l’utilisation de l’informatique dans les juridictions : 89 % des pays ont des bases de données juridiques, donc on pourrait se dire qu’aujourd’hui ces bases publiques existent. Et ce que l’on voit c’est, à côté de cela, une offre privée très dynamique avec des fonctionnalités nouvelles d’accès à la connaissance. Est-ce qu’il n'y a pas un risque d’une justice à deux vitesses, entre un accès à des bases certes transparentes, publiques, larges, et une offre privée beaucoup plus acérée, qui permettrait aux happy few qui peuvent se le payer d’accéder de manière plus approfondie à la connaissance ?
François Paychère : Absolument, le risque est réel. C’est vrai que si les outils d’analyse des données que sont les décisions de justice se contentent d’être l’application de principes simples, d’algèbre booléenne et qu’on a juste des foncteurs comme ET, OU à disposition pour rechercher des décisions pertinentes, c’est clair qu’on laisse un très grand marché aux parties prenantes privées qui vont s’en emparer et offrir des services de meilleure qualité. Donc je pense que l’étape suivante c’est pas seulement de se poser la question de l’ouverture aux données mais aussi de l’analyse des données. Et les États aussi doivent être présents sur ce marché-là.
Yannick Meneceur : Vous avez employé un terme, François, qui m’a interpellé, c’est le terme de « jurisprudence horizontale ». Rendons à César ce qui est à César, ce sont deux collègues magistrats français qui, dans un article paru au Éditions Dalloz, ont employé ce terme-là, en parlant également d’une norme issue du nombre où les juges n’auraient plus comme référence permanente la Cour suprême, la Cour de cassation, mais un regard permanent dans une sorte de rétroviseur. Que pensez-vous de la possible révolution sur la construction de la jurisprudence que serait l’open data ?
François Paychère : Je crois qu’il y a plusieurs questions en une seule.
D’abord cette question de la création horizontale du droit, qui est quelque chose qui, évidemment, nous surprend un peu. Nous avons tous appris qu’il y a une hiérarchie des tribunaux, que le droit est fixé par une juridiction suprême et que les tribunaux, qui se trouvent en-dessous de cette juridiction suprême, n’ont qu’à appliquer ce qui, comme ça, coule d’en haut. Mais en fait ça se passe pas comme ça, concrètement. Dans la vie d’un tribunal vous avez des collègues qui sont à côté de vous, qui sont plus expérimentés, qui ont déjà tranché, dans les pays où ça passe encore devant un juge, x centaines voire x milliers de divorces, ou qui ont déjà réglé x centaines d’affaires de mandats, de contrats d’architecte ou de ce que vous voulez, et qui vont vous guider dans vos premiers pas de jeune magistrat en vous indiquant dans quelle direction, eux, sont allés. Et ils ont créé, comme ça, une espèce de corps de règles un peu secondaires qui est leur propre petit univers jurisprudentiel, mais qui est là, qui existe et qui a réglé la situation des parties. Puis ce jeune magistrat ou cette jeune magistrate va acquérir de l’expérience et se faire aussi son petit dossier de modèles pertinents. Maintenant ce n’est plus possible avec l’accélération de la création de normes, mais on a tous connu des vieux collègues qui avaient écrit tout ça sur des fiches cartonnées légèrement jaunies par le temps et par leurs doigts. Ils avaient créé du droit, ils avaient fait de la création horizontale. Maintenant, si on met ensemble tout cela, on a, en effet, une création horizontale du droit, et je crois que le concept qui est développé par ces deux collègues est tout à fait juste. On passe de l’être au devoir-être à un niveau tout à fait horizontal.
Yannick Meneceur : Comment articuler ce constat partagé, naturellement, par ceux qui ont déjà connu, pratiqué, l’institution judiciaire, comment l’articuler avec de la théorie du droit ? Ce que je veux dire par là, c’est : est-ce qu’on n’ajoute pas aux termes de la loi un autre élément issu de ce nombre-là ? Par exemple la moyenne des décisions, la moyenne d’une prestation compensatoire, par exemple, calculées par ces systèmes-là, ne viennent-elle pas surajouter à la loi ?
François Paychère : Absolument. On va reprendre la métaphore que vous avez utilisée tout à l’heure qui est celle du rétroviseur. C’est vrai que ce faisant, on conduit, en quelque sorte, en regardant dans le rétroviseur et uniquement dans le rétroviseur, ce qui d’ailleurs n’élimine pas le danger du crash. Restons à ce conducteur qui regarde dans le rétroviseur, c’est exactement ce qu’on fait en matière d’open data : on collectionne des décisions qui ont déjà été rendues et on essaie, à partir de cela, de tirer des régularités pour résoudre des cas qui sont présents voire les cas futurs. Est-ce que cela est vraiment dérangeant ? Est-ce que le fait que, en matière de réparation du préjudice corporel, on a accepté pendant x années qu’un petit doigt ça valait tant, qu’un pouce ça valait un peu plus, surtout si on était dentiste, etc., est-ce que c’est quelque chose qui doit être remis en question à chaque fois parce qu’on va se contenter d’appliquer des principes législatifs, ou bien est-ce qu’on peut tirer parti de l’expérience qui découle de cette masse de décisions de première instance ? Je crois que le deuxième terme de l’alternative est meilleur : tirons parti de l’expérience !
Yannick Meneceur : Bien sûr. Et pour en conclure avec ce sujet-là, une autre remarque et une autre question qui est de se dire : est-ce que chaque affaire est totalement similaire ? C’est-à-dire qu’en effet la recherche de travail de jurisprudence fait qu’on essaie de rechercher des similarités dans les affaires, mais est-ce qu’un juge qui serait noyé sous la masse des décisions ne trouverait pas dans le barème une solution un peu automatisée ? N’y a-t-il pas un risque d’automatisation de la justice justement autour de barèmes qui viendraient se substituer à la loi ?
François Paychère : Oui.
Yannick Meneceur : Merci d'y avoir répondu !
François Paychère : Le danger existe, il est vrai, mais il existe à mon sens pour plusieurs raisons. Je ne sais plus qui a dit « l’ennui naquit un jour de l’uniformité » et c’est vrai qu’il y a des contentieux répétitifs. Si on prend l’exemple des pays dans lesquels les divorces se déroulent encore immanquablement devant un juge, il y a pas un contentieux qui soit plus répétitif que celui du divorce, et vous n'empêcherez jamais un magistrat d’avoir ses petits barèmes en tête lorsqu’il s’agit de fixer la contribution compensatoire ou de fixer une pension, etc. Donc moi je préfère encore qu’on ait accès à cette information-là par le biais de l’open data plutôt que de laisser cela dans le secret des cabinets ou bien, comme on l’évoquait tout à l’heure, au fond de la mare dans la gueule de la carpe.
Sophie Sontag Koening : Bon ! Dans la continuité, on a parlé de l’utilisation de cette masse, moi je vais vous parler particulièrement des données. Qui dit mise à disposition massive de ces données, de ces décisions de justice, implique aussi potentiellement d’avoir accès à des données qui sont sensibles. On sait, à l’heure actuelle, que les éléments nominatifs sont enlevés le plus possible des publications des décisions de justice, alors forcément on peut supposer que le travail d’anonymisation va être accru par ce flux qui va lui aussi s’accroître. Selon vous, quels sont les enjeux du big data sur ce point-là, sur la protection des données personnelles des parties au procès ?
François Paychère : C’est un enjeu très important et je pense que personne n’a encore trouvé la bonne solution. Laissez-moi partir d’un exemple déjà ancien, qui est celui de mes études de droit, où nous apprenions – il s’agit de la Suisse – qu’une dame qui s’appelait madame Lou, qui était institutrice, s’était plainte du fait que, pour un travail égal, elle était moins payée que ses collègues de sexe masculin – de genre masculin dirait-on maintenant –, et le tribunal fédéral a sanctionné le canton en question en l’obligeant à payer à fonction égale tous ses fonctionnaires, tous ses agents publics de la même manière. C’était l’arrêt Lou. À cette époque-là, tous les arrêts comportaient le nom des parties, en tout cas les arrêts de la juridiction suprême, et je gage que personne ne s’est vraiment intéressé à savoir qui était madame Lou !
Maintenant, lorsqu’il reste des noms c’est quelque chose d’exceptionnel, du coup, l’attention est attisée par le fait qu’on voit encore des noms. Cela étant, je pense qu’il y a un deuxième paradoxe, qui est le fait qu’on peut modeler nous-mêmes ce que nous considérons comme notre sphère privée, je prends l’exemple de Facebook où les gens révèlent beaucoup de choses sur eux-mêmes, là ils sont pas tellement sensibles à la violation de leur sphère privée puisque, sans en savoir peut-être l’ampleur, mais jusqu’à un certain point…
Yannick Meneceur : Volontairement.
François Paychère : Oui, ils concèdent cette violation alors qu’on est très frileux, très précautionneux dans le domaine judiciaire. Je pense que s’agissant des parties, la pseudonymisation est une bonne solution.
Yannick Meneceur : Est-ce qu’on peut juste rappeler la différence entre anonymisation, pseudonymisation ?
Sophie Sontag Koening : C’est vrai qu’on parle d’anonymisation mais en réalité, comme vous le dites, tout n’est pas anonymisé.
Yannick Meneceur : L’utilisation d’un pseudonyme permet des recoupements statistiques ou d’une autre manière ; on utilise à chaque fois la même manière de le coder, si je puis dire, ou de l’oblitérer, de le cacher, de façon à ce qu’on puisse ensuite l’utiliser, encore une fois, pour des finalités statistiques ou autres, alors que l’anonymisation dans les décisions, c’est changer de manière tout à fait aléatoire les noms.
François Paychère : Alors peut-être, je n’ose pas dire de manière plus claire…
Yannick Meneceur : Si, vous pouvez.
François Paychère : Pour qu’on soit bien d’accord – je parle sous le contrôle de Sophie –, je crois qu’on parle de pseudonymisation lorsqu’on n’enlève pas tous les éléments qui permettent de caractériser une personne, une entité, où subsiste le risque de ré-identification postérieure, alors que quand on parle d’anonymisation, en principe ce risque-là est totalement éteint. Entre parenthèses, il n’est jamais totalement éteint, puisqu’à partir de données totalement anonymes comme le lieu où on se trouve – sans avoir repéré la personne – le lieu, le numéro de carte de crédit et le type d’achat, des chercheurs américains ont réussi à recréer comme ça des listes de noms alors que cette donnée n'était, en principe, pas disponible. Mais revenons-en à notre sujet. Je crois que la pseudonymisation est nécessaire, parce que c’est le seul moyen, de manière globale, d’assurer une certaine protection de la personnalité et je pense que la charge de ce travail doit revenir à des organismes étatiques et ne doit pas être laissée au privé. Ça, c'est pour les parties.
Après, il y a un débat dont on m’accordera, autour de cette table, qu’il est très franco-français, c’est la question du nom des magistrats.
Sophie Sontag Koening : Ça c’est une autre question, effectivement, j’en venais à ce point. Vous dites, pour les parties privées, que tout est question de balance des intérêts. Vous parliez de Facebook, chacun s’accorde et publie les données qui le concernent tel qu’il le veut, mais l’autre question, c’est effectivement pour les personnes extérieures, les juges, les avocats, pour leur part, qu’en est-il ?
François Paychère : Commençons avec les magistrats et les magistrates. Il y a environ deux ans j’animais une session de formation à l’ENM [École nationale de la magistrature], et j’avais pris comme exemple un fameux site français, Supra Legem8, site qui comporte le nom des présidents de juridiction, des présidents des cours administratives d’appel qui statuent en matière de droit des étrangers. Je prends ça comme exemple et je dis à ces juges – c’était des juges judiciaires qui étaient là – « voilà un site français qui publie le nom de magistrats », et je fais quelques projections à l’écran. Arrive le moment de la pause, tout le monde s’égaille dans la cour. Une collègue revient, au début de la séance suivante, en disant vous aviez raison. Et je lui dis : « Écoutez, je n’ai pas l’habitude de mentir, si je vous dis que ce site publie les noms, c’est ça ». Elle avait tapoté comme ça sur l’ordinateur pendant la pause et elle avait découvert qu’elle avait des collègues, certes juges administratifs, mais dont le nom apparaissait en public. Ça paraît, pour certains en France, totalement illégitime, et je pense que ça découle directement de cette conception totalement théorique du juge qui ne serait que la bouche de la loi.
Maintenant vous traversez à nouveau la Manche – on va me dire que j’aime bien me baigner, mais retournons de l’autre côté de la Manche –, et là-bas le principe est totalement inverse : vous pouvez prendre les journaux anglais, même ceux qui se qualifient eux-mêmes de quality papers, et vous voyez que lorsqu’on rend compte d’un procès, lorsqu’un jugement est rendu public, même un jugement de première instance, le nom de la magistrate et du magistrat apparaît sur des supports électroniques, donc le risque de rebond existe aussi totalement. Si on pense à cette affaire tragique de l’incendie de cette tour près de Londres l’an dernier, le gouvernement a décidé de nommer un juge à la retraite pour faire une sorte de commission d’enquête pour se pencher sur les causes de l’incendie et les journalistes sont tout de suite allés chercher dans les banques de données disponibles un historique de décisions qu’il avait rendues en matière de droit du bail. Ils avaient le sentiment que c’était quelqu’un qui était plutôt défavorable aux locataires et plutôt favorable aux bailleurs. Ce juge a dû assumer cette position.
Yannick Meneceur : Justement, on va avancer puisque nous arrivons lentement vers la fin de la chronique, que peut-on réellement apprendre du sens des décisions des magistrats, quand bien même on arriverait à le quantifier ? Est-ce qu’on est sûr que l’on révèle des biais ou est-ce que l’on ne révélera pas plutôt des particularités par exemple territoriales, économiques, sociales ? Vous évoquez les baux, on pourrait évoquer, par exemple, l’attribution des enfants aux mères ou aux pères par les juges aux affaires familiales. Est-ce qu’en examinant leurs décisions on révèle des biais ou est-ce qu’on examine, en réalité, ce qui se passe sur leur territoire ? En d’autres termes, quelle est la différence entre la corrélation et la causalité ?
François Paychère : Je ne vais pas répondre tout de suite à votre question.
Yannick Meneceur : C’est dommage !
François Paychère : Pour être très court, je pense qu’il y a des systèmes dans lesquels c’est légitime, comme le système anglo-saxon, ça tient aux traditions, les systèmes où les juges sont élus à une élection directe, à une élection populaire. Dans les systèmes comme le système français ça n’apporte rien, ça n’a aucun sens supplémentaire d’indiquer le nom du magistrat et, en fait, en plus de ça le biais va être très important parce que, pour revenir au droit des étrangers, c’est clair que si vous siégez dans une ville portuaire comme Marseille ou bien si vous siégez dans une petite ville au milieu du territoire, vous n'allez pas avoir face à vous le même genre d’étrangers, donc pas le même genre de contentieux, donc le biais est inévitable.
Sophie Sontag Koening : Pour finir, je pense à certains juges spécialisés, notamment les juges qui connaissent des affaires de terrorisme, de grande criminalité, pour ces derniers, est-ce qu’il y aurait pas, finalement, des risques à voir leur identité dévoilée comme ça ?
François Paychère : J’ai envie de dire que c’est un risque inhérent à la fonction ; ce n'est pas un risque inhérent à la publication.
Yannick Meneceur : Pour conclure, il y a quand même quelque chose dont il faut parler. Nous avons tous parlé de transparence, encore une fois c'est un objectif qui est tout à fait identifié, mais est-ce que la transparence qui est aujourd'hui recherchée par l’open data ne confinerait pas sous une nouvelle forme de totalitarisme, quelque part ? Est-ce que, parce que vous n’avez rien à cacher, vous devez être totalement transparent ?
François Paychère : Ce que vous venez d’énoncer est totalement effrayant. Il y a en effet souvent cette idée dans la discussion publique que, dans la mesure où on n’a rien à cacher, alors on peut être totalement transparent et, énonçant cette phrase, on jette par-dessus bord la protection de la sphère privée. C’est vrai que les instruments d’analyse de données, la mise à disposition de données massives, comporte ce danger d’atteinte à la sphère privée mais ce n’est pas propre au phénomène de l’open data en matière de droit.
Yannick Meneceur : Encore une fois, pour boucler sur le sujet avec le nom des juges, est-ce que dans cette transparence, la recherche de biais ou l’utilisation par de la justice prédictive – on ne développera pas ce thème-là aujourd'hui – est-ce qu’on n'essaierait pas de contrôler les juges, aussi, d’une certaine manière ? Il y a de la discipline, vous l’avez évoqué sous ce terme-là, le terme de jurisprudence, d’égalité sur le territoire si jamais c’est recherché, mais est-ce qu’il n'y aurait pas des moyens, peut-être, de justement remettre en cause cet équilibre cher à Montesquieu ?
François Paychère : Je gage que la chancellerie a d’autres moyens de discipliner les juges que de devoir recourir au biais qu’est l’open data, au biais de l’ouverture des données au public. Je pense qu’il y a des moyens beaucoup plus simples de faire la police des juges pour ceux qui ne se révolteraient pas.
Yannick Meneceur : Nous allons en terminer là avec la chronique et l’entretien, merci beaucoup François Paychère pour cet échange très ouvert et très libre sur l’open data.
[Pause musicale]